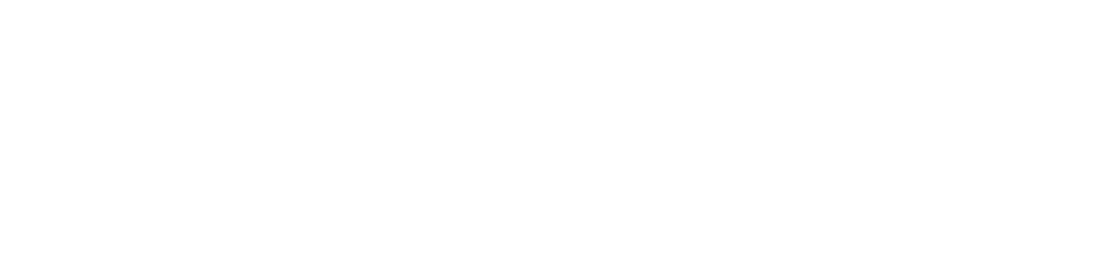Entre l’envoi en mission des Douze que nous entendions dimanche dernier, et leur retour auprès de Jésus, l’évangile de saint Marc raconte la mort de Jean-Baptiste.
Elle a eu lieu loin de là. Nous sommes ici avec Jésus en Galilée. Il est allé à Nazareth ; il se dirigera ensuite, après la multiplication des pains, vers Bethsaïde, au nord-est du lac de Galilée, tandis que la mort de Jean-Baptiste a lieu très loin au sud, à plus de 150 kms, à l’est de la Mer morte, au château de Macheronte, le palais du roi Hérode qui y fêtait son anniversaire.
Il n’y a que deux fêtes d’anniversaire dans toute la Bible, Pharaon dans l’Ancien Testament (Gn 40, 20) et le roi Hérode Antipas dans le Nouveau Testament.
Le site de Macheronte, dans l’actuelle Jordanie, est de toute beauté. Il est situé en haut d’une colline, avec une vue magnifique. Il ne reste aujourd’hui que les ruines de la forteresse que le roi Hérode le Grand, le père d’Antipas, avait fait construire ou plutôt reconstruire vers l’an 30 avant Jésus-Christ comme base militaire sur un lieu stratégique.
Dans l’évangile de saint Matthieu, quand Jésus apprend la mort de Jean-Baptiste, « il se retira et partit en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les foules l’apprirent et, quittant leurs villes, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut saisi de compassion envers eux et guérit leurs malades » (Mt 14, 3).
Ici dans l’évangile de saint Marc, c’est pour qu’ils se reposent qu’il emmène ses disciples à l’écart.
Est-ce qu’ils sont au courant de la mort de Jean-Baptiste ?
Est-ce Jésus qui leur apprend la nouvelle ?
Est-ce qu’il partage sa peine avec eux ?
Est-ce que le martyre de Jean fait partie de l’enseignement qu’il leur donne, ainsi qu’aux foules ?
Il est probable que oui : Jésus est très clair, et tout l’évangile, sur la puissance du mal, et sur les menaces qui pèsent sur eux.
Les disciples que le Christ avait appelés auprès de lui n’étaient pas des gamins, et encore les gamins de l’époque voyaient des horreurs en vrai, pas sur des écrans, des choses terribles, des souffrances qu’on ne savait pas calmer, des morts qu’on veillait et qu’on respectait. Les disciples étaient des hommes éprouvés, il suffit de lire l’évangile, de voir leurs réactions, et des hommes religieux. Les deux sont liés, car pour être religieux, croyant et pratiquant, il faut avoir le sens du Salut, avoir désespéré et avoir été sauvé.
L’expérience de la vie, dont on ne fait plus grand cas, n’est pas faite seulement de découvertes et d’émerveillements, elle est faite de dangers, de frayeurs, d’erreurs et de drames. A cette époque comme aujourd’hui dans tant d’autres pays du monde, on n’était pas protégé, épargné, et on était conscient de sa fragilité.
Le repos auquel Jésus appelle ses disciples n’a rien à voir avec de l’insouciance.
D’ailleurs il s’interrompt à peine commencé : les foules les rejoignent. L’amour ne prend pas de vacances.
Je n’ai de repos qu’en Dieu seul, mon salut vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je suis inébranlable. (Ps 61, 3.)
Dans les années 70, plusieurs évêques français, conscients d’être les successeurs et les héritiers des Apôtres à qui Jésus avait appris à prier, ont appelé à rallumer dans les villes des foyers de prière.
« Il nous faut inventer une contemplation accordée au rythme citadin » avait lancé le cardinal Marty, archevêque de Paris, en septembre 1973, proposant, alors qu’il atteignait 70 ans, une vision à trente ans : « Il faut à Paris des monastères pour l’an 2000, des communautés d’hommes et de femmes rayonnant la prière dans la pauvreté de leur vie ».
Il faut, disait-il, « mettre à la disposition du peuple de Dieu des éducateurs de la prière (qui soient avant tout des pratiquants de la Parole de Dieu – ce n’est pas l’apanage des prêtres), et des lieux de prière, visibles, accessibles, c’est aussi important que de célébrer visiblement la messe le dimanche » (dans La vie catholique de septembre 1973).
Il partait du constat que « le rythme même de notre vie de fourmilière peut étouffer tout appétit spirituel ou renvoyer sans cesse à plus tard. On a faim mais on ne prend pas le temps de manger. La dépersonnalisation … risque de nous retirer jusqu’au goût d’être nous-mêmes et d’être nous-mêmes devant Dieu ».
Un de ses prêtres devenu Carme, et qui finira Evêque, Guy Gaucher publiait quelques années plus tard, dans un petit livre « Prier dans les villes » (Cerf 1979, réédité en 1990, en cours de réimpression), différents témoignages qui en révélaient la clé : l’intensité.
« Mon lieu, mon terrain d’apostolat, ma part d’héritage, écrivait ainsi une sœur contemplative vivant en HLM, ce n’est pas de toucher le plus grand nombre de gens, ce n’est pas d’aller sur les places et les carrefours ou à des réunions : mon lieu c’est l’intensité ».
Comme disait saint Jean de la Croix, « le plus petit mouvement de pur amour est plus utile à l’Eglise que toutes les autres œuvres réunies ».
Et si c’était cela le vrai repos ?
Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul : oui, mon espoir vient de lui.
Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle : je reste inébranlable. (Ps 61, 7)
Quand on peut être soi-même, quand on peut prendre du temps pour Dieu, un temps d’intensité, quand on peut enfin prendre le temps de manger et méditer la Parole de Vérité.
« Car le monde n’est pas toujours un obstacle à prier pour le monde
Si certains doivent le quitter pour le trouver,
et le soulever vers le ciel,
d’autres doivent s’enfoncer en lui,
pour se hisser, mais avec lui, au même ciel. »
Madeleine Delbrêl
Père Christian Lancrey-Javal, curé
Vous avez la possibilité de recevoir les homélies du Père Lancrey-Javal en remplissant ce formulaire